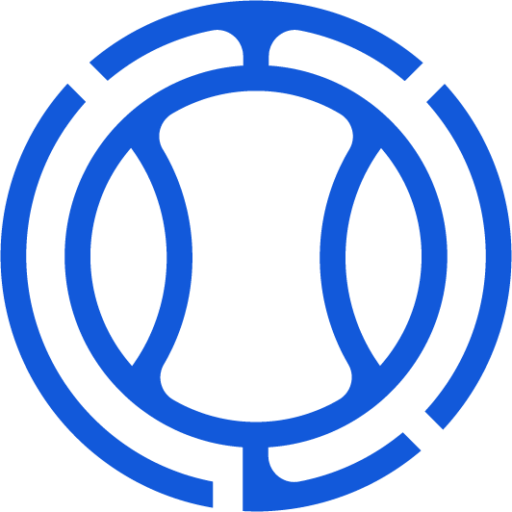Ce mois-ci, Tennis Québec s’est entretenu avec Hugues St-Pierre, entraîneur et préparateur physique au Complexe sportif Forage FTE, ainsi qu’auprès des Équipes du Québec. Fort de plusieurs années d’expérience sur le terrain, il accompagne les jeunes athlètes québécois dans leur développement sportif. Il nous parle ici de l’importance de la préparation physique, de son évolution dans le tennis et des défis rencontrés auprès des jeunes.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a mené vers la préparation physique?
J’enseigne le tennis depuis le début des années 1990. Après plusieurs années comme entraîneur, j’ai décidé de retourner aux études en kinésiologie, où j’ai eu l’occasion de faire un stage avec David Marandon, alors préparateur physique chez Tennis Québec. Cette expérience m’a donné le goût de poursuivre dans cette voie. Aujourd’hui, je combine mon travail d’entraîneur de tennis et de préparateur physique, principalement auprès de jeunes en développement.
À quel moment devrait-on commencer à travailler les capacités physiques chez les jeunes?
De 3 à 5 ans, on mise sur les bases : courir, sauter, lancer, sans spécialisation. Vers 6 à 10 ans, on développe la coordination et la vitesse par le jeu et la diversité des activités, en touchant à plusieurs sports différents. C’est seulement vers 12 ou 13 ans que la force et le conditionnement plus spécifiques deviennent pertinents, selon le développement de chacun.
Comment intégrez-vous la préparation physique dans les programmes de tennis?
Chez les plus jeunes, on combine souvent tennis et préparation physique à travers des jeux ou des exercices de coordination sur le terrain. À partir du sport-études, les entraînements deviennent plus spécifiques, parfois réalisés en dehors du court : musculation, mobilité, endurance, etc. L’important, c’est que les deux approches, tennis et fitness, se complètent. Ce qu’on travaille sur le terrain, on le renforce en dehors du court et vice-versa.
Comment savoir si un jeune joueur est bien préparé physiquement? Est-ce qu’il y a des qualités physiques qui ressortent plus chez un jeune joueur?
La vitesse, l’agilité, la coordination et la puissance sont les principales. Dans les Équipes du Québec on utilise des test (sauts, sprint, agilité) qui permettent de mesurer ces qualités. Ils ne prédisent pas tout, mais nous donnent une bonne idée de la base motrice et de la capacité d’adaptation du joueur. Un enfant qui bouge naturellement, qui s’ajuste facilement à des nouveaux exercices, démontre souvent un bon potentiel.
Quelle proportion idéale recommandez-vous entre le tennis et la préparation physique?
C’est variable selon l’âge et le moment de la saison, mais on peut viser environ 20 à 30 % du temps d’entraînement consacré à la préparation physique. Le suivi devrait être continu, avec des ajustements selon les périodes de tournoi, de récupération ou de développement.
Comment fonctionnent les périodes de repos et de récupération?
Le repos est essentiel. Après une période intensive ou une période de tournois, il faut accorder au moins quelques jours sans tennis. Lorsque la saison de tennis se termine, certains joueurs vont prendre autour de deux semaines complètes sans tennis pour se reposer. Le corps a besoin de temps pour récupérer. Le sommeil et la nutrition restent les deux clés fondamentales pour bien récupérer et prévenir la fatigue ou le surentraînement.
Selon vous, comment la préparation physique a-t-elle évolué dans le tennis au fil des années?
Les meilleurs jeunes sont aujourd’hui aussi bons, voire meilleurs qu’avant, car la préparation physique est mieux intégrée aux programmes. Cependant, la base générale est plus faible qu’autrefois : les enfants bougent moins, jouent moins dehors et manquent parfois de motivation à l’effort. Le défi, c’est de maintenir l’engagement, de leur donner le goût du travail et de la progression.
Un dernier conseil pour les parents et les jeunes athlètes?
Le développement sportif repose sur la constance et l’équilibre. Bien dormir, bien manger et écouter son corps sont des habitudes aussi importantes que l’entraînement lui-même. Les progrès durables passent toujours par la régularité et la patience.